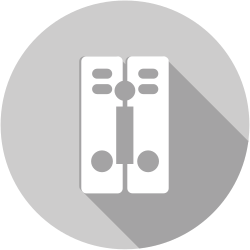Commission des affaires européennes
Présidence de Pieyre-Alexandre Anglade, député de la quatrième circonscription des Français établis hors de France
La diffusion semble rencontrer un problème.
Retrouvez tous les directs et vod de l’Assemblée nationale sur notre portail vidéo.
La commission des affaires européennes n’est pas une commission permanente : ses 48 membres sont également membres d’une commission permanente en application du principe de double appartenance.
Sa mission est de contrôler l’action européenne du gouvernement et de suivre les politiques européennes développées par les institutions de l’Union. À ce titre, elle examine les projets de textes européens qui lui sont soumis au titre de l’article 88-4 de la Constitution, vérifie si les projets d’actes législatifs européens sont conformes au principe de subsidiarité, prend l’initiative de résolutions européennes destinées au Gouvernement ou aux institutions européennes, participe aux conférences interparlementaires européennes…

Actualités

Sur le rapport de Mme Isabelle Rauch, députée Horizons de Moselle, la commission des affaires européennes a examiné, le samedi 28 février 2026, trois propositions de résolution européenne relatives aux allocations chômage des travailleurs frontaliers, au télétravail frontalier et à l'affiliation sociale des enfants de travailleurs frontaliers.
Ces trois propositions de résolution invitent à moderniser les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale afin de garantir les droits des travailleurs frontaliers et d'assurer une répartition plus équitable des charges entre les États membres, dans un contexte de forte progression du nombre de travailleurs frontaliers et d'évolution des formes familiales et des modes de travail.
Concernant les prestations chômage des travailleurs frontaliers, la proposition de résolution appelle à transférer la responsabilité de l'indemnisation à l'État de dernière activité, alors que le système actuel d'indemnisation par l'État de résidence entraîne un déficit annuel de 800 millions d'euros pour l'Unédic. En parallèle, il apparaît nécessaire d'améliorer l'accompagnement des demandeurs d'emploi frontaliers, en automatisant et dématérialisant les procédures, et en facilitant l'exportation des droits dans un autre État membre.
La proposition de résolution européenne relative au télétravail invite à harmoniser les règles fiscales et sociales applicables aux situations transfrontalières, afin d'en faciliter le recours. Elle propose notamment de consacrer dans le droit commun un seuil de 49,9 % de télétravail sans changement de régime d'affiliation sociale.

Le mercredi 7 janvier 2026, M. Éric Pauget, député des Alpes-maritimes, a présenté, au nom de la Commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne visant à demander l’inscription de la mouvance des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes.
La proposition s’inscrit dans le cadre des instruments existants de l’Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme, au premier rang desquels figure la liste européenne des organisations terroristes, établie après les attentats du 11 septembre 2001. L’inscription sur cette liste emporte des effets juridiques concrets, notamment le gel des avoirs, l’interdiction de tout financement et un renforcement de la coopération policière et judiciaire entre États membres. La proposition de résolution souligne le caractère politique plutôt que religieux de la mouvance, son implantation transnationale et les risques qu’elle fait peser sur les valeurs démocratiques, la cohésion sociale et la sécurité intérieure de l’Union. Elle appelle à une réponse européenne coordonnée face à une menace qui dépasse le cadre strictement national. La proposition de résolution européenne a été adoptée le 7 janvier 2026 par la commission des affaires européennes, saisie au fond.
Lire la proposition de résolution européenne adoptée par la commission